Le village global aura-il lieu ?
Qu’en est-il du village global thématisé par Mc Luhan et très en vogue il y a une dizaine d’années avec l’expansion d’Internet ? Ce « village global », créé par la transmission d’informations électroniques instantanées, signifierait notre ouverture au monde et s’accompagnerait d’une prise de conscience face aux problèmes contemporains.
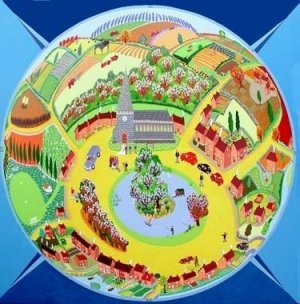
C’est en devenant spectateurs et témoins des événements internationaux médiatisés, en prenant « contact avec la planète », que l’on réaliserait que la solidarité internationale sur le terrain peut venir en aide et ceux et celles qui vivent des situations difficiles sur la planète, et développerait une conscience planétaire.
Mais, les médias sont ambivalents : à la fois ils rassemblent en communauté, créent cohésion, rassemblent dans la discussion, et ils sonnent aussi le temps de la solitude organisée devant son écran de télévision ou d’ordinateur, aliènent, coupent de la vie, coupent du temps, coupent de la réalité, et ne permettent pas de réelle rencontre avec autrui.
La drôle
d’empathie télévisuelle.
Après le jeune Mohamed, la jeune Omayra, récemment encore
dans l’actualité, une image a indigné la communauté internationale. Houda,
celle de jeune palestinienne de dix ans, hurlant de peur et d’horreur sur le
cadavre de son père ensanglanté. Cette image a indigné la communauté internationale,
provoqué de vives réactions en Palestine. Pour nous, derrière notre poste, ces
images engendrent une émotion, une
empathie, mais ça s’arrête là, on ne nous propose ni d’agir, ni de manifester.
Il nous apparaît avec douleur que nous ne pouvons rien y faire !
Finalement, nous aurions peut-être préféré ne pas savoir, tant on se sent
frustré, pris en otage, agressé par ces images.
Les massacres que la télévision nous fait voir provoquent en nous une réaction de défense, car on sait qu’on ne peut rien y faire. On finit par changer de chaîne, car le traumatisme est réel.
Ou bien, on se laisse aller à la compassion. Mais la compassion devant son poste de télévision n’est qu’un simulacre d’émotion, qu’un simulacre d’empathie fugace devant une personne qui n’est qu’un figurant électronique. C’est la petite larme devant le malheureux candidat d’un jeu de télé-réalité, c’est l’effroi devant le récit d’un séisme au journal télévisé, c’est l’émotion larmoyante devant deux frères jumeaux qui se sont retrouvés sur le plateau de Bataille et Fontaine.
Toutefois,
nous exigeons que les présentateurs de télévision sachent user de compassion, en
ne filmant pas les agonies, les cadavres, et en adoptant le ton "juste".
Télécompatir dans
une société individualiste sans morale : mission impossible ?
Les médias ont du mal à trouver le ton juste lorsqu’ils
apportent des mauvaises nouvelles, et régulièrement des polémiques éclatent,
parce que la société elle-même a du mal avec les questions d’altruisme et de
responsabilité. Les médias ne font que mettre en lumière le problème. Mais, si,
de manière générale, on accepte l’idée de ne pas avoir à répondre aux malheurs
vus dans les journaux télévisés, on tient à ce que le journaliste traite
correctement cette information. Comme si on déplaçait l’exigence. A défaut
d’agir, au moins, parlons-en comme il se doit !
Cette exigence est d’autant plus pesante pour la chaîne qu’elle met en jeu le taux d’audience, et que la télé-compassion est particulièrement difficile. Alors, tantôt le ton est neutre, la voix se fait grave, le visage est sans émotion aucune, tantôt l’œil est larmoyant et la bouche crispée. Tantôt, les images choquent, tantôt on se plaint parce que le sujet est traité avec légèreté.
Ils ont du mal à trouver le ton juste, à se positionner, parce que rien n’est clair dans le domaine moral. A la fois, on s’insurge contre les malheurs d’autrui, mais on ne veut pas faire grand-chose pour l’aider. Donc, la plupart du temps les mauvaise nouvelles défilent, comme si chaque personne décédée ou souffrante était chaque fois la même, anonyme, perdue dans un flot d’informations diverses.
Et, parfois, le présentateur fait des tentatives d’expression de la compassion, et échoue magistralement, comme David Pujadas sur France 2, lors de la catastrophe du cyclone Katrina, quand il a sombré dans le pathos de marketing. : « Si la douleur et l’attente avaient un visage, ce serait peut-être celui de cette femme... Elle recherche désespérément sa sœur disparue après le cyclone... »
Dans tous les cas, une chose est sûre, la compassion sera brève. Le reportage suivant sera nécessairement agréable : audience oblige !
Les
médias m’ont raté.
Le principal problème des médias, c’est qu’ils ne donnent pas
à voir un homme mais un concept, une construction, un homme anonyme
déconstruit, déréalisé, reconstruit, idéalisé, ou évanescent. Autrui n’est plus
un homme, mais un figurant électronique, un concept mort. Il suffit de
songer aux constructions qu’ils font en thématisant une « communauté
musulmane », en usant de concepts comme « les jeunes », en créant
des porte-parole, en faisant comme s’ils étaient une communauté organisée et
unie. Ces concepts sont sans réalité, ils caricaturent le réel, l’organisent, et
le ratent.
L’image capte le réel et donne à voir, comme si ce qu’elle montre, c’était la totalité de la réalité. Donc en fermant autrui sur lui-même dans l’image, elle le rate. A vouloir trop le capter, elle l’enferme, et le rate dans son individualité propre.
Le réel est plus riche que la pensée, que le savoir, ou que l’image construite par la pensée. L’homme échappe à la pensée, et à l’image. Il sera toujours plus que l’image. Ici, on peut penser aux images de marketing humanitaire, au centre desquelles le corps souffrant devient une icone sans réalité. L’altérité prestigieuse est tuée, car le visage, ce n’est pas quelque chose que je vois, mais que je rencontre.
Pas de
village sans la rencontre avec autrui.
La télévision, Internet,
nous donnent l’illusion de rencontrer autrui, alors qu’autrui est raté.
Le dialogue avec autrui n’a pas lieu non plus.
Car dans le langage, il y a du non maîtrisable, du théologique, nous
apprend Levinas dans Autrement
qu’ être et au-delà de l’essence.
La parole est un évènement, une prise de risque, la rencontre d’un autre. C’est
une relation qui préserve la distance. Par sa prétention à comprendre, par ses
zooms, par sa prétention à capter la réalité en direct et à la transmettre, elle
rate autrui, et le tue. Il n’y a plus de complexité, plus d’impondérable :
on coupe ce qui ne convient pas au montage, on ne laisse de la communication
que ce qui est brut d’information. La relation authentique à autrui se fait
dans le discours. Finalement, le rapport
réel, le dialogue, perd sa valeur théologique pour n’être plus qu’information.
Pour parler en termes levinasiens, le dire a disparu, il ne reste plus que le
dit. C’est dans le dire que je réponds à autrui, que je m’éveille à ma
responsabilité, et que je me sens lié à lui.
Or, comme la télévision ne me permet pas de rencontrer autrui, elle ne restitue pas son appel, elle ne permet pas non plus l’engagement avec autrui, cet éveil à ma responsabilité. La preuve, c’est que je n’ai aucun mal à lui couper la parole, en zappant, à ne pas forcément regarder lorsque le présentateur parle.
Sans lien avec autrui, la tribalisation de la planète n’est effective.
Concluons, avec Wolton, qui dans son ouvrage Internet et après ? explique clairement la thèse selon laquelle le village global reste à faire. Le village global est une réalité technique, mais n’est pas une réalité sociale et culturelle. Etre en interaction, ce n’est pas communiquer. La communauté internationale se construit, mais les médias de masse ne permettent pas de réussir cette communauté internationale, du moins, pas encore.
Sources :
-
J.L. Missika, « La télé compassionnelle », L’Express, 19 janvier, 2004. http://l’express.fr
-
J. Gonet, « Le messager de l’insupportable », interview du 3 novembre 2000, www.tocsin.net
-
Endelweld, « Une bonne histoire de télévision », Le Monde diplomatique, décembre 2005.
-
T. Deltombe, « L’islam au miroir de la télévision », Le Monde diplomatique, mars 2004.
-
T. Deltombe, « Quand l’islamisme devient spectacle », Le Monde diplomatique, août 2004.
-
M. McLuhan, « Médias chaud et médias froids », émission de radio "L’histoire comme ils l’ont faite", 30 décembre 1967, http://www. radio - canada .ca
-
H. Dieudeze, « Télévision et tribalisation de la planète », émission de radio "Aux frontières du connu", 8 avril 1979, http://www. radio - canada .ca
-
J.J. Wunenburger, L’homme à l’âge de la télévision.
-
D. Wolton, Internet et après ?.
-
P. Mesnard, La victime écran, la représentation humanitaire en question.
12 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON










