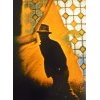L’« Internet » sous-marin de la marine russe
Le consortium Ocean Pribor et l'institut de Volgograd ont conçu Dialog, un système de communication analogique/digital destiné aux submersibles autonomes (Rous, Konsul, Bester) ou aux plongeurs, portée annoncée ? une cinquantaine de kilomètres selon les conditions hydrographiques. « Jusqu'à présent, les moyens de communication sous-marine étaient capables de transmettre des données à une vitesse de 3-10 kbit/sec, ce qui permettait seulement d'assurer un échange de petits messages audio. Dialog a introduit la transmission de données par plusieurs canaux : un signal est divisé en plusieurs paquets qu'on transmet ensuite simultanément via 10 canaux de communication. Cette technique permet de maintenir la connexion à un niveau d'au moins 68 kbit/sec même dans des conditions très défavorables » (source Izvestia).

En l'absence d'informations techniques, la société n'ayant pas répondu à ma demande, ce qui ne me surprend pas..., je me suis livré à un exercice de reverse ingéniering de faisabilité. Il existe quatre principes pour transmettre des signaux sous-marins à distance : optique - magnétique - électrique - acoustique. La méthode mettant en jeu l'optique n'est guère à retenir hormis le laser bleu-vert avec diode photodétectrice à avalanche au silicium qui en est encore au stade des expérimentations. Les ondes électromagnétiques capables de pénétrer la couche d'eau se doivent d'opérer sur des fréquences très basses (very low frequencies) qui permettent aux sous-marins en immersion à faible profondeur de communiquer par Télétypes, ou les extra low frequencies qui elles ne permettent qu'un débit très lent, la transmission d'une lettre prenant une dizaine de secondes. Les ondes électriques permettant la transmission de sons produits par des courants électriques à haute-fréquences modulées en amplitude ou fréquence sont capables de se propager et de se comporter dans l'eau comme des ondes sonores. L'utilisation de ces ondes « hydroniques » (Wallace Ninto) en étant restée au stade expérimental, seules les ondes mécaniques élastiques demeurent adaptées à l'acoustique sous-marine (ASM).
On appelle acoustique sous-marine la partie de la physique qui s'occupe de l'étude des sons et de leur propagation en milieu aquatique. Chacun se souvient que la célérité du son dans l'air est d'environ 330 mètres à température de 0°C et au niveau de la mer. Le son est véhiculé par l'ébranlement des molécules, en conséquence, la vitesse du son diminue en altitude en raison de la raréfaction de l'air, dans le vide le son ne se propage pas. Quand la température s'abaisse, la vitesse de propagation du son diminue, quand la température augmente, la vitesse augmente elle aussi. Par contre, la propagation du son dans l'eau est améliorée en raison des molécules plus nombreuses et plus proches les unes des autres et de son in-compressibilité. Selon la densité de l'eau, de sa température, de la salinité, et de la pression hydrostatique, la vitesse du son varie de 1435 m/sec (eau douce) à 1512 m/sec (eau de mer).
Les sons émis sur une fréquence audible sont très bien perçus par l'oreille immergée, des haut-parleurs sont utilisés lors de ballets aquatiques pour diffuser la musique. Les sons audibles ont une fréquence s'étendant de 16 Hertz pour les basses (en dessous se trouvent les infrasons) à 16 kHz pour les aigus (spectre s'étendant sur 9 octaves), au-delà, on pénètre dans le domaine des ultrasons inaudibles à l'oreille humaine (spectre de 16 octaves). Il est à noter que si les sons aigus (fréquence élevée) sont mieux perçus par l'oreille, ils se propagent bien moins bien que les sons graves. La longueur d'une onde peut être facilement déterminée par le calcul, elle est égale au rapport entre la vitesse et la fréquence le nombre d'oscillations se produisant dans une seconde (l=C/fré). Ainsi, pour la note « La3 » caractérisée par une de fréquence de 435 Hz, sa longueur d'onde dans l'air est donc 331/435, soit 0.762 m, dans une eau pure la longueur de cette même fréquence vaudra 1470/435, soit 3.38 mètres. Une source ultra-sonore opérant sur une fréquence de 20 kHz, par exemple, correspondra en milieu marin à une longueur d'onde de 0,0715 m.
Au repos, les molécules sont soumises à la pression hydrostatique ; l'onde sonore élastique engendre des variations locales de pression, la pression acoustique (exprimée en Pascal) et l'intensité sont liées. L'oreille n'est pas sensible à la différence des fréquences, mais à leur rapport. A signaler que les sons purs, ondes sinusoïdales parfaites, n'existent pas dans la nature. Le timbre (signature sonore) varie en fonction de la nature de la source sonore (un piano délivrant la même note qu'une flute aura un timbre différent), il est en relation avec une fondamentale et des harmoniques plus aiguës que la fondamentale. Attention de ne pas confondre les harmoniques (multiplication de la fréquence par deux) avec les octaves (intervalles), la bande spectrale en ASM s'étend sur plus de 25 octaves !
On s'est donc tourné naturellement vers l'utilisation des ultrasons pour les communications : surface- fond, fond-surface ou fond-fond, en France, un premier appareil a été réalisé par Edmond Henrioud dans les années 60. Il s'agissait de l'appareil ERUS (émetteur-récepteur ultrasonique). La technologie actuelle permet à l'amateur de construire un appareil à ultrasons permettant de communiquer entre plongeurs (les plus aguerris pourront expérimenter le système en Bande latérale unique). Il suffit de moduler la voix au rythme de la modulation d'amplitude et de remplacer le haut-parleur par un transducteur en matériaux piézo-électrique (l'apparition d'un champ électrique sur le transducteur entraîne sa déformation mécanique, le transformant en « membrane » vibrante). Pour matérialiser l'émission d'un haut-parleur ou d'un transducteur ultra-sonore on peut prendre l'exemple d'une pierre qui tombe dans l'eau, son choc à la surface va repousser violemment les molécules et entraîner l'apparition d'ondes (d'oscillations) circulaires et qui ont pour origine le point de chute de la pierre. A mesure que l'on s'éloigne de ce centre, l'onde s'amortit jusqu'à ne plus être décelable. La propagation des sons est sensiblement inversement proportionnelle au carré de la distance, autrement dit, si la distance double, le signal est 4 fois plus faible, si la distance triple, le signal sera 9 fois plus faible. Plus l'affaiblissement est grand, plus la puissance d'émission requise sera importante pour couvrir une portée donnée. Si l'affaiblissement n'est que de 4 dB par kilomètre à la fréquence de 20 kHz, il passe à 18 dB pour 50 kHz, ce qui représente un affaiblissement phénoménal de 900 dB pour 50 kilomètres !
L'article des Izvestia (les nouvelles) n'apporte aucune indication sur les conditions d'évaluation des performances : océan polaire, mer tempérée, océan tropical, ni sur la profondeur et la directivité de la source d'émission, ni sur le moment de l'année. Les écrans acoustiques, les courants, les variations de températures, de salinité, les bruits ambiants, la pression, voilà autant de paramètres capables d'influer sur la qualité de la liaison. Une différence de température ou de salinité va entraîner des variations de propagation allant parfois jusqu'à créer de véritables chenaux sonores ; le son peut aussi venir se « réfléchir » sur la surface, sur le fond, sur un obstacle et l'onde sonore de cheminer par réflexions successives. L'onde incidente (réfléchie) peut parfois interférer et entraîner un changement soudain des conditions de propagation ; si les mobiles se déplacent, la fréquence de réception sera différente de celle de l'émission en raison de l'effet Doppler-Fizeau (glissement de fréquence). Si le signal est en phase, il se renforce, dans le cas contraire cela peut conduire à l'extinction totale du dit signal. Cela nous montre les difficultés et explicite les aléas rencontrés en acoustique sous-marine. Un signal peut être perçu à grande distance pour ne plus l'être dans une zone située plus proche de la source sonore ! Si la source sonore est trop puissante (pression sonore supérieure à la pression hydrostatique), un phénomène de cavitation peut alors apparaître, on aborde alors le domaine de la sonochimie. La libération des gaz contenus dans le fluide peut engendrer des pressions supérieures à 1 000 bars et atteindre des vitesses de 100 m/sec !
La télégraphie est l'équivalent électrique du tam-tam, l'opérateur établit et coupe le signal électrique selon le protocole du code Morse, exemple, une durée brève (1/25 sec) suivie d'une coupure et d'une durée plus longue (1/75 sec) correspondent à la lettre « A ». Vous noterez que la bande occupée par le signal reste faible (une centaine de hertz) puisqu'il ne s'agit pas de transmettre le registre vocal ni la richesse d'un instrument de musique. En électronique (traitement d'un signal), on ne connait que deux états, soit le courant ou le voltage passe, ou pas, on parle de digitalisation, principe à la base de tous les ordinateurs : niveau 1 ou haut, le courant passe - niveau 0 ou bas, il est interrompu, principe du tout ou rien. Ces deux états suffisent à transmettre l'information. C'est un principe quelque peu similaire que l'on retrouve à la base des MODEM (modulateur-démodulateur) l'état 1 ou 0 est traduit par un basculement entre deux fréquences audibles, par exemple 1 300 et 2 100 Hz.
Dès les années cinquante, les opérateurs téléphoniques se sont tournés vers le multiplexage qui permet de transmettre des données ou sons provenant de différents appareils sur un seul support. On distingue le multiplexage par répartition de fréquence (MRF), chaque liaison se fait dans une plage de fréquence bien précise sur une bande partagée afin de ne pas venir « mordre » sur la bande voisine, c'est un peu ce que l'on retrouve sur nos postes radio avec les GO, PO, etc. Le multiplexage par répartition de temps (MRT) prélève à chaque laps de temps déterminé (la période T correspond à l'inverse de la fréquence) et pendant une durée extrêmement brève un échantillon du signal transmis sur la totalité de la bande passante. La fréquence d'échantillonnage (fe = 1/T) doit être le double de la fréquence maximum du signal (théorème Nyquist - Shannon). S'il s'agit par exemple d'un signal vocal téléphonique, 300 à 3,3 kHz, la fréquence sera de 6,6 kHz arrondie à valeur standard proche 8 kHz, qui permettra un débit de 8^8 soit 64 bits/sec.
Le procédé présenté dans l'article utilise plusieurs canaux et expédie des paquets comme pour le protocole Internet. Les informations numérisées (bits) sont transmises par paquets ou datagrammes (blocs de longueur constante) ce qui permet d'en acheminer différentes parties par des canaux distincts rendu possible par le multiplexage par répartition orthogonale de fréquence (OFDM). La bande passante allouée est partagée entre différentes porteuses, chaque poste peut ainsi occuper une bande de fréquence et transmettre simultanément plus d'informations (destination des paquets, puissance d'émission, accusé réception, code erreur, etc.) sur différentes porteuses très proches les unes des autres en raison de l'étalement du spectre utilisé. Les avantages sont : une meilleur résistance aux perturbations, une portée plus grande, la perte d'une porteuse n'affecte que peu le signal, et les codes de correction d'erreur permettent la reconstitution d'une partie perdue. Afin d'accroître les distances de communication sans alourdir le matériel embarqué, le poste « maître » est plus puissant et la partie réceptrice est équipée de filtres pour exploiter au mieux les signaux faibles et atténuer les bruits parasites. L'optimisation : du rapport signal/bruit, de la puissance d'émission et du débit, peut trouver un début de réponse avec les modulations : Multiple Frequency Shift Keying, Phase Shift Keying - Multi Carrier Modulation ou l'étalement de spectre et le codage de Hadamard.
Cette « innovation » ne risque pas de déstabiliser le Landerneau de la recherche des communications extrêmes, seulement les mammifères marins, domaine de la bioacoustique animale. Des chercheurs planchent sur un réseau Internet ultrasonique hauturier relayé par satellite capable d'alerter par Smartphone de l'imminence d'un tsunami, d'une pollution, de l'intrusion d'un submersible, et d'activités dans les domaines de l'exploration des ondes sismiques, gravi-métriques, de la météorologie, ou le suivi des mammifères. J'espère avoir réussi à simplifier l'aspect technique en utilisant un langage accessible aux non techniciens en m'en tenant à des notions de base accessibles au plus grand nombre, et être parvenu à démystifier l'article des Izvestia.
°°°°°°°°°°°°°
3 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON