Télé : moins de rires et plus de ricanements
On connaît bien David Abiker par la télévision : pendant six ans, à la droite du « père », il est intervenu sur le plateau de l’émission « Arrêt sur images » de Daniel Schneidermann. On se souvient bien de ses piquantes analyses d’images et de son numéro de duettiste avec Judith Bernard. On connaît bien, également, le travail de David Abiker à la radio : cela fait plusieurs années maintenant qu’il explore et défriche internet pour les auditeurs de France Inter puis de France Info. On connaît un peu moins bien sa carrière d’écrivain...
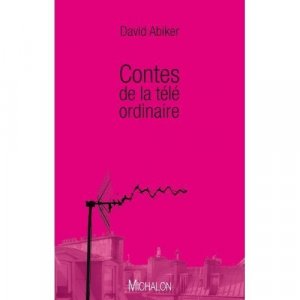
(Contes de la télé ordinaire de David Abiker, éditions Michalon, 2008)
- T’as lu le dernier livre d’Abiker ?
- Abiker, le mec de la télé ?
- Mais non, l’autre...
Déjà salué par la critique et le public pour ses deux précédents livres : Le Musée de l’homme (2005) et Le Mur des lamentations (2006), David Abiker consacre son troisième opus à la télévision. Avec Contes de la télé ordinaire, il invente un moyen inédit de parler de la télévision, une « manière » parfaitement originale, qui éloigne son ouvrage des textes écrits par les classiques « critiques TV » (D. Schneidermann, A. Rémond, etc.). Abiker aborde le problème en écrivain et fait de la télévision un objet fétiche, tour à tour nostalgique, détestable et fascinant, autour duquel vont tourner les différents « contes », qui en disent autant sur la télévision elle-même que sur notre modernité. Ces brèves histoires, relevant à la fois de la chronique et de la fiction, sont effectivement des « contes » en ce que l’on en tire toujours un enseignement doux-amer, parfois teinté d’un cynisme salvateur (notre société a besoin de moins de rires, mais de plus de ricanements...), et nous permettent de constater encore et toujours le rapport passionnel qui nous lie à la petite lucarne.
David Abiker part d’un constat autobiographique amusant : il est le dernier, dans sa maisonnée, à s’intéresser encore à la télévision... Madame préférant écouter des MP3 dans la baignoire et les filles ne jurant plus que par les plates-formes vidéo (qui est une de ces abominations modernes permettant de revoir ad nauseum, en plus petit et en plus moche, ce que l’on a déjà vu à la télé)... notre héros, le fameux Maouh qui était déjà au cœur des précédents livres d’Abiker, s’interroge avec nostalgie sur la télévision, comme un média au bord de mutations considérables, et qui est en train de perdre son rôle de liant social au sein des familles et de la société. Maouh regarde la télévision se transformer de média collectif, de média que l’on partage en famille, en média individuel, dont on picore bien souvent les contenus sur le web. « Des jeunes gens qui attendent une semaine pour voir le troisième épisode de Thierry La Fronde ça n’existe plus. Aujourd’hui, les jeunes n’attendent plus, ils vont eux-mêmes chercher les images. Ils fabriquent aussi. Sans demander l’autorisation. Nicolas et Pimprenelle, c’est fini. ».
Mais c’est avec humour que David Abiker fait ce constat de décès de la télévision d’avant. Avec distance aussi. Il n’hésite pas à nous entraîner dans un rêve stupéfiant, où il ramène le château de la Star Ac à l’âge de pierre, avec le concours d’un Alain Finkielkraut de fantaisie, plus vrai que nature. « Fink a donné un coup de Doc Martins dans l’ampli... ». Abiker nous invite aussi à le suivre dans une imaginaire et désopilante animation commerciale d’hypermarché « Sur ma veste la caissière a collé un badge ’vu à la télé d’autrefois’ ». On suivra aussi Maouh, avec une joie intense, au bord de l’acte d’achat d’un écran plat ou dans une visite surréaliste au Palais de Tokyo, à la rencontre d’une installation vidéo consacrée à la série TV Dallas.
Mais, si l’humour est omniprésent, c’est avec acidité que David Abiker regarde les programmes télévisés. Il épingle souvent la société hyper-festive, qui conduit un président de la République française à faire, innocemment, ce lapsus effrayant, parler de « fêter l’anniversaire de la rafle du Vel-d’Hiv »... Abiker commente avec justesse : « Confondre la fête et la célébration n’est pas un crime. Chacun peut se tromper. Mais nous savons au fond que la société médiatique consomme célébration et fête de la même manière, avec le même appétit glouton qui fait traiter la rafle comme la plage (ndlr : référence à Paris-Plage) ; et la plage comme la sortie de prison de Paris Hilton ». De fait, la société moderne a fait le choix du nivellement absolu des données et des valeurs... Le relativisme a eu la peau des derniers muscles du « sérieux » qui structurait l’ancienne France...
L’auteur regarde, amusé, le culte voué par la société moderne aux nouvelles icônes laïques à la mode : les femmes otages (Aubenas, Betancourt, etc.), par exemple. « Ma fille m’a supplié. J’ai fini par accepter. On allumera une bougie ce soir pour la libération de Florence Aubenas »... Il se moque de l’usage des « mots-images » en politique, qui en mettent plein la vue, mais ne veulent rien dire : « J’ignore quelles réalités renferment ’maisons de proximité’, ’tremplin et forum éco-industriel’, ce verbiage de concepteur rédacteur territorial en mal de magie. (...) ’citoyen’ fonctionne assez bien pour assainir les mots qui puent. Essayez Café citoyen, c’est tout de suite mieux que bar-tabac. ». Dans un autre registre, l’auteur dénonce avec humour le goût moderne pour les euphémismes bien pensants, et particulièrement la propension des journalistes à parler de « plus démunis » pour évoquer les pauvres et de parler de « plus aisés » pour évoquer les riches. Abiker adore, aussi, regarder Chirac. Ca se sent. Et ça fait tourner magnifiquement la machine à nostalgie : « En fait, on n’écoute plus Chirac. On se branche dessus aussi machinalement que lui se branche sur nous depuis quarante ans. Chirac n’est pas un président. Jacques Chirac est une fréquence ».
Impossible, ici, de faire la liste exhaustive de ces « contes » de la télé ordinaire. On y retrouvera avec un plaisir égal (dans le contexte de cette télé relativiste en diable) Bayrou sur son tracteur, des bébés congelés, des tabloïds que l’on lit en vacances, des poulets grippés, l’abbé Pierre superstar, le pape en gisant, Cécilia Sarkozy en provisoire reine de France, etc. On soulignera peut-être le conte Avoir tort contre Clémentine qui est certainement le plus désopilant de tous, et qui s’amuse à démontrer qu’il est strictement impossible d’avoir le dessus, médiatiquement, sur les tenants de l’empire du Bien : « Je ne peux plus allumer i-Télévision sans voir Clémentine Autain qui a raison. Avoir tort contre Clémentine Autain qui a raison, c’est aussi une fatalité cathodique. Qui la contredit bascule immédiatement dans le camp de la réaction, de la vieillesse, de la droite, du Medef, bref de la méchanceté moderne ».
On notera, pour finir, que l’auteur a fait précéder chacun de ses petits contes d’un petit extrait de dialogue. De ce genre de petites choses que l’on se dit en famille devant la lucarne...
- Tu préfères Florence Aubenas ou Ingrid Betancourt ?
- Bah j’aime bien les deux...
Bienvenue dans la télévision moderne, au bord de la métamorphose... une télé où tout vaut tout et où chacun vaut n’importe qui... une télé inondée de rires (enregistrés ou non), à qui les ricanements de David Abiker sont une belle réponse.
Documents joints à cet article

Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON








