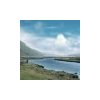La robinsonade des poissons fumés

Sur une île déserte, deux individus ont choisi des grammes d’or comme monnaie pour s’échanger leurs productions respectives. Un individu est pêcheur. L’autre est agriculteur. Le pêcheur de poissons a l’habitude de vendre son poisson fumé au prix de 1 gramme d’or pièce. Et l’agriculteur à l’habitude de vendre 1 gramme d’or chaque kilo de blé. Les deux habitants acceptent volontiers ces prix d’échange et les considèrent comme équilibrés.
Su l’île déserte, la quantité de grammes d’or est limitée à 100 grammes d’or. L’agriculteur prête 100 grammes d’or au pêcheur. Le prêteur, c’est à dire l’agriculteur, demande à l’emprunteur, c’est a dire le pêcheur, de lui rembourser 110 grammes d’or. La situation du prêteur est celle du banquier qui prête de la monnaie.
Nous sommes ici exactement dans le cas du paradoxe que nous voulons étudier. Une dette de 110 grammes d’or, alors qu’il n’existe que 100 grammes d’or sur l"île déserte. Et pourtant l’emprunteur va rembourser les 110 grammes d’or au prêteur. Comment va-t-il faire ? Non, il n’y aura ni magie, ni escroquerie. Seulement une grande logique fondée sur la nature exacte du billet de banque.
L’emprunteur est le pêcheur. L’agriculteur est le prêteur. Le pêcheur produit des richesses et pêchant et en fumant ses poissons. Son client est le prêteur agriculteur. A chaque fois que le pêcheur-emprunteur vend un poisson fumé à l’agriculteur prêteur, le pêcheur reçoit 1 gramme d’or. Lorsqu’il a vendu 100 poissons, le pêcheur emprunteur possède 100 grammes d’or. Il rembourse le prêteur agriculteur des 100 grammes d’or de l’emprunt.
C’est une erreur fréquente de croire qu’il existerait autant de masse monétaire que de quantité de marchandises à vendre. Le remboursement des intérêts d’un prêt est une transaction commerciale parmi d’autres. La masse monétaire est 1000 fois moindre que le volume des transactions commerciales. La quantité de monnaie importe peu pour assurer les échanges monétaires.
54 réactions à cet article
-
Robinsonade vrai en monnaie or, complètement fausse en monnaie électronique actuelle.
Car le capital (les 100 euros) sont crées lors de l’emprunt, et détruit lors du remboursement.
Si dans votre robinsonade, vous détruisez les 100 grammes d’or, vous serez de bonne foi. Et vous m’en direz les conclusions.
Pour l’heure, c’est une débandade.-
Excusez les fautes d’orthographe précédentes, mais elles me semblent plus futiles que votre faute de logique ou votre mauvaise foi.
Retournez lire la robinsonade de Mac Douglas, l’île des naufragés, elle est actualisée par rapport à la votre de quelques siècles, sinon quelques millénaires. -
@Tzecoalt
Vous objectez que la robinsonade serait exacte pour une monnaie-or, mais inexacte pour une monnaie de crédit, utilisant la monnaie moderne. Le raisonement de la robinsonade des poissons fumés ne dépend pas de la nature de la monnaie. Dans cet exemple, vous pouvez changer la nature de la monnaie, vous aurez exactement le meme fonctionement des échanges qu’avec la monnaie-or de la robinsonade.
-
L’emprunt bancaire émettant une monnaie temporaire, l’or étant une monnaie permanente, vous risquez ici de ne plus jamais être pris au sérieux, devant une telle confusion, ignorance ou mauvaise foi.
-
@Tzecoatl
A ma connaissance, le concept de "monnaie temporaire" n’existe pas. Ni le concept de "monnaie permanente". Si un tel concept de monnaie existait, il serait contraire à la définition de la monnaie. -
Cela révèle votre ignorance du sujet.
Croyez-vous que les banques gardent le capital remboursé, comme les 100 grammes d’or dans votre robinsonade ? Et le reprêtent ?
-
L’auteur nous dit qu’à sa connaissance il n’y a pas de différence entre ’l’argent permanent’ et ’l’argent temporaire’.
Audrait faire un stage dans les Banques Centrales et lire le Prix Nobel d’Economie Maurice Allais !
- Pour les Banques Centrales
Monnaie permanente M0 : http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BASE
Monnaie temporaire (crédits) M2 : http://research.stlouisfed.org/fred2/series/M2?cid=29
Surveillés de près depuis longtemps, définition complète ici.
Pour Maurice Allais c’est ici, et l’explication de l’effondrement actuel par lui même et ses disciples là. -
@Galuel
Ainsi, vous appellez les billets en papier, et les pièces métalliques, "monnaie parmanente". Et vous appellez "monnaie temporaire" la monnaie électronique provenant des credits bancaires. Je ne vois pas bien l’interet de faire une telle dictionstion de nature entre ces deux supports matériels d’une meme monnaie, et surtout dans ce débat sur la robinsonade. -
Donc, la quantité de monnaie est sans importance pour assurer les échanges, ce qui est bien démontré.
Ce que ne comprend pas Tezcoal, c’est que ce sont les variations de quantité de monnaie qui sont nuisibles.
Ce qui plaide bien sûr pour que la monnaie fiduciaire soit en permanence convertible en métal, ou tout autre panier de marchandises. C’est à dire que sa valeur en soit déterminé par le contrat, et non par la loi. C’est à dire une monnaie privée et non monopolistique.
-
@Le Spéripate :
"Donc, la quantité de monnaie est sans importance pour assurer les échanges, ce qui est bien démontré. "
Ce qui absolument faux, ce n’est pas 100 grammes d’or qui feront tourner l’économie mondiale (Pas plus que les 145000 tonnes exploitées jusqu’à aujourd’hui), et si c’était le cas, je ne suis pas sûr qu’un atome d’or (pour peu que ce soit pratique) qui puisse rémunérer le salaire journalier du plus pauvre esclave de cette terre.
Et qu’un défenseur de la liberté autour de la réserve fractionnaire vienne nous donner des leçons, c’est le pompon.
Par ailleurs, je comprends très bien que tu veuilles détourner l’attention de l’ineptie de cet article, dans une cathédrale idiologique aussi solide que le nauséux libéralisme que tu défends et dont tu dois certainement jouir.
Gdm insulte Aristote et par voie de conséquence lui-même. Nous sommes bien en système exponentiel.
1kg d’or en l’an 0 à 5% vaudrait aujourd’hui plus de la masse de la terre en or.
Où les banques privées iront-elles trouver cette exponentialité ? En multipliant la monétisation de matières premières, via la réserve fractionnaire.
Votre discours tient surtout à sécuriser les rentes du système financier,par un discours sans aucun fondement philosophique, mais uniquement corporatiste : valeur-temps, "l’argent travaille", "le temps c’est de l’argent", l’échange crée de la valeur.
Cela permet facilement de s’approprier à bon compter la valeur du travail d’autrui, sa propriété, reportant sur le reste de l’économie une casse cyclique, suite à des objectifs globalement et strictement intenables et outrageusement usuraires.
Mais l’hypocrisie des monnaies libérales sert surtout à faire perdre du temps et de l’énergie à ses contradicteurs, n’est ce pas ? Ou encore d’entretenir le mythe fallacieux (reconnu par des libéraux) du système bancaire écossais.
-
Je ne ferai pas de réponses à ce post. Comprenez vous pourquoi ?
-
C’est gentil d’avoir essayé, mais vous n’êtes pas convaincant du tout.
Votre opinion vaut celle-là, assez incompatible avec la vôtre vous en
conviendrez.
On sait que les banquiers crée l’argent des prêts ex-nihilo, que cela ne
nécessite aucun travail significatif avec des équipes d’ouvriers sur le
chantier durant des mois (contrairement à la construction d’une maison par
ex).
Expliquez-nous pourquoi, alors que l’achat d’une habitation est un coût majeur
pour tous les budgets, quand nous devons emprunter 100000 euros pour devenir
propriétaire d’une habitation (dont le prix a doublé quasiment en 10 ans
quand nos salaires stagnaient) nous devrions rembourser qui 140000 euros et
qui 175000 ?
Quel travail rémunérons-nous à un tel niveau ?
Qu’est-ce qui empêche l’Etat de créer à taux zéro des prêts immobiliers en
se couvrant simplement sur les menus frais engendrés par le suivi des
remboursements et les vérifications de niveau d’endettement en amont ?
Un commandement divin, une loi fondamentale de l’Univers comme la constante
de structure hyperfine ou la vitesse de C dans le vide ?
Quand des Etats, des individus en sont à emprunter pour payer seulement le
service de la dette, tout le monde comprend que le système a abordé une vrille
potentiellement mortelle.
Autre chose, le taux de croissance de l’économie à ses limites. Quand une
économie de 100 milliards de $ de PNB passe à 105 elle a crû de 5%. Quand
elle atteindra 1000 milliards de $, une augmentation de 10 milliard en un
an de PNB donnera 1% seulement de taux de croissance.
Le principe du prêt avec intérêt ignore cette tendance vers le zéro du taux de croissance
dans un monde finis..-
@marcoB12
Vous me dites que mon article n’est pas convaincant. Dans le cas de cette monnaie-or, la démonstration est triviale. Je l’ai néanmoins explicité longuement et en l’illustrant avec cette exotique robinsonade. Or le cas de la monnaie moderne ne différe en rien au cas de la robinsonade en ce qui concerne la quantité de monnaie nécessaire pour les échanges.
Vous ne trouverez personne qui vous prête à taux zero, Sauf s’il souhaite vous faire un cadeau. Mais cette question est différente du theme proposé par mon article. -
@ l’auteur
Votre petit exercice tient debout car le pêcheur est supposé trouver
sans peine les dix poissons "payant les intérêts".
Direction le monde réel : En 1997 j’ai envie d’acheter une maison à 100000 euros
mais préfère encore épargner 10 ans.
En 2007 la maison de mes voeux vaut 200000 euros, j’ai 100000 euros (enfin) et
je dois emprunter 100000 euros pour l’acheter et devrait rembourser au prêteur
150000 euros.
Sauf que mon salaire n’ayant quasi pas bougé en 10 ans et étant peu susceptible
d’évoluer, je suis dans une situation bien pire que le pêcheur.
Où vais-je trouver les poissons (les pèpètes...) ?
Vous oubliez l’échelle de l’économie mondiale dans un monde finis où la quantité
de poissons dans les océans, ou de pétrole dans le sous-sol peut sonner la "fin
de démo" très facilement.Pour la plupart des emprunteurs (qui pêchent de moins
en moins de poissons) rembourser les échéances implique d’emprunter un peu plus
d’or, qui impliquera plus de poisson à pêcher, dans une vrille potentiellement
irrécupérable.
Par ailleurs la Réserve Fédérale comme la Banque du Japon prêtent quasi à taux zéro.
Pourquoi les banques centrales le pourraient et pas les Etats pour certains emprunts ? -
J’ai du mal à comprendre ce que l’auteur de cet article espère démontrer. Si c’est une tentative pour désamorcer les critiques à l’égard de la création de monnaie virtuelle, elle est plutôt désespérée. La caractéristique du système financier actuel est justement qu’il permet de créer de la monnaie à partir de rien. Essayez donc de convertir tout l’argent virtuel en or...
Je retiens surtout de cette robinsonnade que le pêcheur ne bouffe pas tant qu’il n’a pas remboursé l’agriculteur

-
@marcDS
Le but de mon article est très limité. Il vise uniquement à montrer que la quantité de monnaie importe peu pour permettre aux agents économiques de facturer et de payer leurs prestations entre eux. Le paiement des interets d’un prets de l’emprunteur à son banquier ne différe pas d’une autre prestation de service entre deux individus.
Et pourtant, le seul paiement est le fondement d’une étrange critique de nombreux intervenants de agoravox pour dire que la masse monétaire devrait sans cesse augmenter pour permettre le paiement des interets. Et, selon eux, cette constante augmentation sera une cause de l’instabilité monétaire. Cette courte et simple robinsonade a pour but de tordre le cout à cette objection sans fondement sérieux. -
"Et pourtant, le seul paiement est le fondement d’une étrange critique de nombreux intervenants de agoravox pour dire que la masse monétaire devrait sans cesse augmenter pour permettre le paiement des interets."
Et pourtant, la masse monétaire de l’eurozone est de 9373 milliards d’euros fin nov 2008 et les crédits de 15358 milliards d’euros à la même date :
http://www.ecb.int/press/pdf/md/md0811.pdf page 3 counterparts
-
@Tzecoatl
Vous indiquez que la masse monétaire M3 est de 9000 alors que les credits est de 13000(nombre arrondis au milliers). Je vous remercie de citer ce bon exemple pour illustrer mon article. Ces nombres illustrent que la masse monétaire sont inférieurs aux credits bancaires. C’est normal. Et pourtant, tous les crédits pourront être remboursés. -
Il est surtout évident que vous êtes là pour faire de la désinformation et de la propagande.
-
@Tzecoalt
Vous me faites un proces d’intention. A mon avis, un débat est plus utile lorsqu’on accepte de considérer que l’interlocuteur est sincere, meme lorsqu’on juge qu’il est dans l’erreur. Apporter des arguments pour critiquer les propos de l’interlocuteur me semble plus difficile, mais plus utile. Imaginer que l’autre serait stupide, ignorant ou menteur gene l’échange des propos. -
Quelque chose m’échappe dans cette "grande logique fondée sur la nature exacte du billet de banque"
Il existe 100 gr d’or sur l’ile, le détenteur de cet or est donc le pêcheur puisque l’agriculteur lui a prêté.
Le pêcheur détient donc l’intégralité de l’or présent sur l’ile.
Avec quel or l’agriculteur peut-il payer le poisson du pêcheur ?-
@ecophilpatJe vous remercie de pointer deux point peu clairs dans cette robinsonade. J’y parle de "la nature du billet de banque". Cela n’éclaire pas mon raisonnement. Mais j’aurai du ajouter un paragraphe entier pour expliquer que le raisonnement est le même pour expliquer que la quantité de monnaie, fut-elle en or ou en billet de banque, importe peu pour permettre les échanges entre les individus.Je suppose que les 100 grammes d’or qui sont sur l’île sont tous aux mains de l’agriculteur. Je ne l’avais pas dit explicitement, pensant que c’était implicite. Mais votre question est légitime. Mon article aurais du le préciser. Cela n’aurait pas alourdit mon exposé de préciser, dans le détail, chacune des opérations :1. l’agriculteur possède les 100 grammes d’or et le pêcheur ne possède pas d’or.2. le pêcheur vend 100 poissons fumés a l’agriculteur et obtient 100 grammes d’or.3. Il en résulte que l’agriculteur ne possède plus d’or et que le pêcheur a 100 grammes d’or.4. Le pêcheur rembourse le capital prêté, soit 100 grammes d’or a l’agriculteur.5. Il en résulte que l’agriculteur possède 100 grammes ’or et le pêcheur ne possède plus d’or.6. A ce stade de l’histoire, le pêcheur a une dette de 10 grammes d’or envers le banquier.7. le pêcheur vend 10 poissons fumés a l’agriculteur et obtient 10 grammes d’or.8. le pêcheur verse les 10 grammes d’or a l’agriculteur pour payer les intérêts de sa dette.9. ensuite, le pêcheur a entièrement remboursé sa dette avec les intérêts de sa dette.10. La situation est alors que l’agriculteur possède 100 grammes d’or, et le pêcheur n’a pas d’or.Cette énumération des 10 situations successives est-elle trop laborieuse ou au contraire vous semble-t-elle plus claire ?
-
votre argumentation ne veut rien dire par rapport au systeme actuelle.
1- l’argricuteur et le pecheur produise tous les deux des richesses réel(la banque crée à partir de rien).
2- l’agriculteur prete au niveau de se qu’il possede et pas plus(alors qu’une banque se le permet).
Que se passe t’il si le pecheur veut empreinter 200 or ?
Que se passe t’il si pour rembourser dans le temps le plus rapide(pour eviter de payer plus d’interet) le pecheur exploite toute sa ressource de poisson ? -
@Barbaring
Cette robinsinade se limite à montrer que la masse monétaire peut etre inférieure à la masse des credits bancaires. Les questions que vous posez dans votre post ne concernent pas cette robinsonade. -
Je suis désolé mais cette énumération ne rend pas, à mes yeux, la chose plus claire
A quelle étape de votre énumération l’agriculteur prête-t-il l’argent au pêcheur.
1. Soit l’agriculteur détient les 100 gr d’or et dans ce cas le pêcheur ne lui doit rien.
2. Soit l’agriculteur prête les 100 gr d’or au pêcheur et dans ce cas il (l’agriculteur) ne peut acheter le poisson au pêcheur.-
@ecophilpat
En effet, vous avez raison. La suite des évenements est incorrecte dans l’article, ainsi que dans mon post. Il fallait lire ce qui suit :
1. L’agriculteur possède les 100 grammes d’or et le pêcheur ne possède pas d’or.2. L’agriculteur prête les 100 grammes d’or au pêcheur avec un intérêt de 10 grammes d’or.3. L’agriculteur n’a plus d’or. Le pêcheur détient 100 grammes d’or.4. Le pêcheur devra rendre ces 110 grammes d’or à l’agriculteur incluant les intérêts.5. Le pêcheur rend les 100 grammes d’or empruntés.6. L’agriculteur possède ainsi 100 grammes et le pêcheur n’a plus d’or.7. Le pêcheur vend 10 poissons fumés et obtient 10 grammes d’or.
8. Le pêcheur verse les 10 grammes d’or pour payer les intérêts de sa dette.
9. Ainsi, le pêcheur a entièrement remboursé sa dette avec les intérêts de sa dette.
10. L’agriculteur possède 100 grammes d’or, et le pêcheur n’a pas d’or.
-
-
La démonstration se tient !
Le pecheur a emprunté pour rien !
En gros, il a bossé pour engraisser l’agriculteur. Son travail a permis au "banquier" de manger 110 poissons.
Le pauvre pecheur a jeuné pour rembourser...
Maintenant, si l’agriculteur veut continuer sur le même train de vie, il faut qu’il persuade le pecheur pour recommencer l’opération....
Si l’agriculteur se sent l’appétit féroce, quoi de mieux que de faire passer 100 g de sable pour 100 g d’or et de proposer un prêt de 200 ; comme ça, il pourrait mager 2 fois plus !
Et du coup, on comprend mieux l’intérêt d’augmenter le volume de monnaie.
discours sans prétention, je ne suis qu’un pauvre pêcheur ! alors moi l’économie je n’y connais pas grand chose, ... avoir tout ces poissons à attraper !
-
Voilà une preuve de plus pour confirmer mon sentiment.
La terre sera sauvée le jour ou l’espèce humaine aura disparue.
Ces habitants n’ont été mis au jour que pour détruire.
La situation est irrécupérable, leur bêtise est incommensurable.
Bonne année 2009 et les autres combien ?????????????-
@aye
[pour eviter les entetes techniques dans votre copier-coller, cliquez sur l’icone "winword"]
Vous écrivez que "la Terre sera sauvé le jour ou l’espèce humaine aura disparue". Ce n’est pas le thème de mon article. Mais l’idée que vous défendez est très surprenante. -
Vous dites, en abordant un aspect logique lié à la circulation de l’argent, que Paul Grignon "Tombait dans cette même erreur de raisonnement".
Dans son film d’animation, PG insiste surtout sur le mécanisme de "L’argent Dette", où les banques créent l’argent électronique lors de l’émission d’un prêt.
Le problème qu’il soulève, est alors celui de la possibilité de créer une institution bancaire (Aux Etats Unis), avec un faible capital de départ, et de pouvoir ensuite "Créer" un argent fictif, correspondant aux montants des prêts accordés.
L’emprunteur (Non banquier) devra rembourser sa dette à l’aide d’une création de richesses réelles (Le produit d’un travail).
La mise en correspondance de l’activité de la banque, avec celle de l’emprunteur, met en exergue le fait que d’un coté on puisse créer de la richesse à partir de rien, et que de l’autre on ait une activité bien concrète qui se matérialise par des heures de travail, des investissements, etc.
Un autre aspect du film, porte sur l’histoire de la banque, qui est, on le constate, bien peu glorieux.
Finalement, Paul Grignon met en avant dans son œuvre un ensemble de concepts qui échappent aujourd’hui au commun des mortels, et qu’il est donc bon de rappeler afin que chacun puisse s’en instruire.
Je vous trouve donc bien injuste avec lui.
NF-
@nightflightVous revenez sur ma critique de la vidéo de Paul Grignon. Vous rappelez que cette vidéo prétend que l’argent d’un prêt bancaire serait créé "à partir de rien". Dans mon article, c’est une autre erreur de Paul Grignon que je vise. C’est l’erreur populaire qui consiste à imaginer que, pour échanger, il serait nécessaire que la masse monétaire soit supérieure ou égale à la dette. Mon article tend à montrer que la quantité de monnaie importe peu pour permettre les paiements et les échanges économiques.Néanmoins, je vais répondre à votre objection sur cette autre erreur de Paul Grignon, laquelle erreur est de croire que l’argent serait créé "à partir de rien". Dans sa vidéo, Paul Grignon avait bien remarqué que la reconnaissance de dette de l’emprunteur, cette créance sur l’emprunteur, avait de la valeur. Mais, malheureusement, il n’en tire pas les conclusions. Cette créance sur l’emprunteur se vend et s’achète, ce qui prouve qu’elle a de la valeur. Nul individu, attentif à son intérêt individuel, n’achèterait une créance qui n’aurait pas de valeur.Une reconnaissance de dette sur un emprunteur a plus de valeur que la somme empruntée. Cette valorisation élevée de cette créance tient compte d’un risque que cette créance devienne un jour douteuse. La valeur de cette créance provient de la capacité de l’employé de banque à savoir choisir des clients qui rembourseront leur dette.Certes l’argent d’un prêt bancaire est créé au moment précis du prêt bancaire. Au même moment, l’emprunteur signe sa reconnaissance de dette. C’est ainsi que l’argent ainsi créé est garantit par l’engagement du banquier. Cet engagement du banquier sur la valeur de la monnaie qu’il émet est conforté par la valeur de la créance sur l’emprunteur, créance possédée par le banquier. L’ensemble des créances sur les emprunteurs est un actif qui a beaucoup de valeur. Il est ainsi inexact de prétendre que l’argent serait créé à partir de rien, ou serait créé "ex nihilo".
-
le paradoxe c’est que celui qui dit préter cent ne les a pas c’est celui qui emprunte qui crée ces cent et devra offrir dix en plus...
-
Comment faisaient nos parents qui n’achetaient que lorsque la somme nécessaire était réunie ?
Parfois, ils empruntaient aux membres de leur famille mais faisaient tout leur possible pour éviter la banque.
Ils travaillaient et pouvaient économiser en sachant qu’ils leur fallaient plusieurs mois ou plusieurs années mais ils pouvaient faire des projets.
En d’autres termes, ils adaptaient leurs besoins à leurs revenus sans qu’un banquier vienne y mettre son nez.
Ce qui est inquiétant, c’est que cette idée simple, ne pas avoir besoin d’une banque, devient une idée archaïque.
-
@Blé
Vous citez la génération précédente qui économisait au lieu d’acheter à crédit. Le crédit permet d’obtenir plus vite et donc de beneficier plus vite d’un bien économique. Pour une entreprise, c’est important de pouvoir emprunter. Ainsi, le crédit permet d’augmenter la production de richesses dans le monde. -
"Sur une île déserte, 2 individus..."
Je vous cite : "l’agriculteur prête 100gr d’or au pêcheur.".
Celui-ci pourra le rembourser capital et intérêts (10gr) en
vendant des poissons (préalablement trouvés et pêchés) au prix
de 1gr d’or par poisson.
A qui va-t’il les vendre sinon au seul occupant de l’île en dehors
de lui ?
Donc il pêche et vend 110 poissons à l’agriculteur (à qui d’autre)
et se retrouve avec 100gr d’or.
Fort de cette démo de coin de table et en arrivant à la conclusion
inverse (le pêcheur a 100gr d’or à la fin et 10 poissons) vous avez
la prétention de vouloir démontrer que la masse monétaire peut être
inférieure à la masse des crédits. Certes, quelques-uns parmi nous
s’en doutaient un peu.
Mais vous oubliez le monde réel dans lequel les besoins de financement
dépassent le stock d’or (donc de monnaie) disponible sur l’île et le
côté aléatoire de la pêche qui peut obliger à rééchelonner la dette (donc
s’endetter un peu plus), voire un volume de poissons disponibles inférieur
au volume souhaité (pénurie de ressources naturelles), des pêcheurs concurrents,
le fait que les intérêts ne sont nullement une somme forfaitaire décidée
une fois pour toute, payable à échéance indéterminée, etc...
Vous avez donc à mon sens oublié l’essentiel et cette démonstration
dissimule la réalité bien plus qu’elle ne la montre...-
@marcoB12
La robinsonade de l’ile deserte a, en effet, pour but d’illustrer qu’il est possible de payer, meme si la masse monétaire est inférieure au total des emprunts. Il existe meme une quasi-totale déconnexion, à court terme, entre la masse monétaire et le montant des emprunts. Une masse monétaire peut etre créée uniquement pour le moment de l’échange. -
Voila une autre robinsonnade qui n’arrive pas vraiment aux memes conclusions.......
http://www.fauxmonnayeurs.org/articles.php?lng=fr&pg=9-
@arfarf
J’ai regardé le lien que vous citez fauxmonayeurs.org. Une fable sur une île déserte avec un banquier. La réfutation de cette fable est la suivante. La banquier refuse que les emprunteurs remboursent les 1080 sous le pretexte qu’il n’ont que 1000. L’attitude du banquier est sotte et contraire à l’interet de tous, y compris du banquier lui-meme. En effet, il peut émettre 80 de monnaie et preter les 80.
La réfutation de la fable est que les emprunteurs peuvent rembourser les 1000. Les 80 non versés sont alors une dette bien moindre. L’interet a 80 euros est moins lourds a payer.
Mais, il existe une autre réfutation de cette fable. Le banquier dit qu’en cas de non remboursement, il sera payé par une partie des biens appartenant à l’emprunteur. Le rédacteur de la fable s’est trompé en disant que la sanction serait la confiscatyion totale des biens de l’emprunteur. A mon avis, la lourdeur de cette sanction est absurde et constitue une erreur de rédaction du rédacteur de la fable.
Pour payer les 80 euros, il suffit donc d’offrir au banquier des marchandises dont la valeur marchande est 80 euros.
En modifiant ces qq erreurs de rédaction, les conclusions de la fable s’inversent et démontre l’utilité de la monnaie et du banquier.
-
Au contraire on peut remarquer que le banquier vie sur le dot des autres sans rien produire. Alors qu’ils peuvent vivre sans lui.
-
@Barbaring
Le metier d’un banquier est preter de l’argent, ici preter des billets. Tout billet est un engagement du banquier envers l’usager. Un billet de banque est un contrat unilatéral entre le banquier et un usager. La rémunération du banquier est le taux d’interet. Il n’est pas question de tenter de justifier l’existence d’un taux d’interet. En effet, si un emprunteur accepte ce taux d’interet, c’est que l’emprunteur y voit un avantage. Cette explication suffit a justifier l’existence d’un taux d’interet.
-
Oui à partir que cette argent lui appartient, se qui dans la realité n’est pas le cas(il s’agit d’argent fabriquer à partir de rien).
Facile de demander le remboursement de l’argent fictif qui n’a demander que 10secondes de la part du banquier a creer par du travail reel pendant plusieurs année qui en plus doit payer un interet pour quoi "le risque" quand on voit que le risque et rembourser par les etats quand celle ci coule. -
1. L’agriculteur possède les 100 grammes d’or et le pêcheur ne possède pas d’or.
2. L’agriculteur prête les 100 grammes d’or au pêcheur avec un intérêt de 10 grammes d’or.
3. L’agriculteur n’a plus d’or. Le pêcheur détient 100 grammes d’or.
4. Le pêcheur devra rendre ces 110 grammes d’or à l’agriculteur incluant les intérêts.
5. Le pêcheur rend les 100 grammes d’or empruntés.
6. L’agriculteur possède ainsi 100 grammes et le pêcheur n’a plus d’or.
7. Le pêcheur vend 10 poissons fumés et obtient 10 grammes d’or.
8. Le pêcheur verse les 10 grammes d’or pour payer les intérêts de sa dette.
9. Ainsi, le pêcheur a entièrement remboursé sa dette avec les intérêts de sa dette.
10. L’agriculteur possède 100 grammes d’or, et le pêcheur n’a pas d’or.
Ok, cet plus clair ainsi.
10 poissons ont remplacé les 10 gr d’or manquant
Donc à la suite de ces opérations l’agriculteur c’est enrichi de 10 poissons alors que le pêcheur c’est appauvri d’autant.
Cela illustre bien le fait que celui possede ou qui créer les devises et qui les prête avec intérêts s’enrichit au détriment de celui qui travail. Mais cela nous le savions déjà.
Mais cette histoire ne peut se jouer qu’à 2 et ne fonctionne que dans un cadre bien limité et sous certaines conditions qui sont :
1. que les 2 participants n’aient pas la même profession
2. que l’agriculteur soit à la fois le prêteur et le client du pêcheur
3. que l’agriculteur ne préfere pas manger des pommes
Mais surtout il n’y a que dans une robinsonade que l’on peut remplacer l’or par des poissons.
De fait, cette robinsonade montre très vite ces limites et les conditions nécessaires pour arriver à la solution souhaitée sont bien loin de ce qui se passe dans la réalité.
Vous devriez lire celle proposée dans le message précedent elle est beaucoup plus représentative du système monétaire actuel.
-
@ecophilpatcertes, mon nouveau texte et cohérent, mais il me semble insuffisant. je vous propose un toute autre robinsonade :1. Le décor1.1. Sur une île déserte, il y a deux habitants, un agriculteur et un pêcheur.1.2. Chacun des deux possède 50 grammes d’or.1.3. La quantité totale d’or sur l’île est ainsi de 100 grammes.1.4. Malgré leur isolement, les deux habitants ont gardé l’amour de l’or.1.5. Le pêcheur pêche et fume environ 1000 poissons fumés par an.1.6. L’agriculteur récolte environ 1000 kilos de blé par an.1.7. L’agriculteur récolte une fois par an.1.8. Chaque jour, le nombre de poissons pêchés est variable.2. Les échanges2.1. Le pêcheur vend son poisson fumé pour 1 gramme d’or2.2. L’agriculteur vend son kilo de blé pour 1 gramme d’or.2.3. Les deux habitants considèrent que ces prix de vente sont équitables et stables.2.4. Lorsque un acheteur manque d’or, et que le vendeur l’accepte, l’acheteur signe une reconnaissance de dette de 1 gramme d’or.3. Les billets3.1. Une reconnaissance signée par l’agriculteur est un "billet-agriculteur".3.2. Une reconnaissance signée par le pêcheur est un "billet-pêcheur".3.3. Le pêcheur possède des grammes d’or et des billets-agriculteur.3.4. L’agriculteur possède des grammes d’or et des billets-pêcheur3.5. Le pêcheur a qq billets-pêcheur. Ces billets n’ont pas de valeur pour lui.3.6. L’agriculteur a qq billets-agriculteur. Ces billets n’ont pas de valeur pour lui.4. La compensation des billets4.1. Les deux habitants se réunissent parfois pour la "compensation" des billets. Le pêcheur possède N billets-agriculteur. L’agriculteur possède P billets-pêcheur. Si N est inférieur à P, le pêcheur remet N billets-agriculteur à l’agriculteur. Et l’agriculteur remet N billets-pêcheur au pêcheur.4.2. Apres une telle réunion de compensation, l’un des deux habitants conserve une dette envers l’autre.4.3. Les deux habitants savent que leur production dépend du hasard des conditions climatiques.4.4. Les deux habitants sont travailleurs, honnêtes et en bonne santé. Ils ont confiance que la dette de l’un sera honorée plus tard.5. L’emprunt de l’agriculteur5.1. L’année précédente, la récolte de blé fut médiocre. Au mois de mai, avant la nouvelle récolte, l’agriculteur n’a plus de blé. Le blé dans le champ est en herbe et le temps est propice. La prochaine récolte sera probablement bonne.5.2. L’agriculteur n’a plus d’or. Il n’a plus de blé. Il n’a aucun billet-pêcheur.5.3. L’agriculteur aura besoin de 200 grammes d’or pour acheter sa nourriture avant la récolte.5.4. Le pêcheur possède 100 grammes d’or.5.5. Le pêcheur ne possède aucun billet-agriculteur5.6. L’agriculteur ne possède aucun billet-pêcheur.5.7. Le pêcheur prête 100 grammes d’or. En échange, le pêcheur reçoit 100 billets-agriculteur.6. Le remboursement de l’emprunt6.1. Chaque jour, l’agriculteur achète des poissons fumés au pêcheur. Le paiement se fait d’abord en or, puis par des billets-pêcheur.6.2. Le temps de la récolte du blé est arrivé. L’agriculteur n’a plus d’or, ni de billet-pêcheur.6.3. Le pêcheur possède 100 grammes d’or et 100 billets-agriculteur.6.3. L’agriculteur fait sa récolte.6.4. L’agriculteur vend 200 kilo de blé au pêcheur6.5. Le pêcheur paye avec 50 grammes d’or, 100 billets-agriculteur, et 50 billets-pêcheur6.6. Ainsi, l’agriculteur possède 50 grammes d’or et 50 billets-pêcheur.6.7. Le pêcheur possède alors 50 grammes d’or et 50 billets-agriculteurs.7. Trois monnaies7.1. Il existe trois monnaies distinctes : le gramme d’or, le billet-pêcheur, le billet-agriculteur.7.2. Ces trois monnaies ont la même valeur nominale, le gramme d’or.7.3. Le valorimètre des trois monnaies est le gramme d’or.7.4. Ces trois monnaies sont différentes parce que leur émetteur est différent.7.5. Une transactions supérieures à la quantité d’or est possible.7.6. La monnaie "billet-pêcheur" est garantie par le pêcheur, émetteur de cette monnaie.7.7. La monnaie "billet-agriculteur" est garantie par l’agriculteur, émetteur de cette monnaie.8. Obligation des émetteurs de monnaie8.1. La garantie du pêcheur consiste en son obligation de fournir soit un gramme d’or, soit un poisson fumé. Cette obligation du pêcheur consiste en un contrat unilatéral envers le possesseur du billet-pêcheur.8.2. La garantie de l’agriculteur consiste en son obligation de fournir un gramme d’or, soit un kilo de blé. Cette obligation de l’agriculteur consiste en un contrat unilatéral envers le possesseur du billet-agriculteur.8.3. Un gramme d’or n’a pas d’émetteur. Chaque gramme d’or doit être vérifié et pésé à chaque transaction.9. Echange et quantité de monnaieLa quantité d’or disponible ne limite pas le montant d’un échange.
-
« Bis repetita, perseverare diabolicum »
Et un autre article affligeant de quelqu’un qui, visiblement, a oublié ses cours élémentaires de science. Votre pêcheur serait bien inspiré de ne pas exploiter le carcharhinus longimanus (99% de la population éradiquée sur les 50 dernières années dans le Golfe du Mexique - source : le regretté Dr. Ransom A. Mayer) faire fi ainsi de l’écosystème dans un modèle global où nous pillons des ressources limitées est d’une rare stupidité et d’une cupidité sans faille, mais il n’y a que les fous et les économistes... vous connaissez probablement la suite.
Prendre un sous-système biaisé pour tenter de justifier de façon simpliste un bidouillage honteux ne relève pas de l’information mais de la propagande.
-
Comparaison n’est pas raison. Celle-ci est particulièrement déraisonnable : l’auteur a semble-t-il appris l’économie en jouant au Monopoly.
Il est vrai que la complexité n’est pas l’apanage des esprits étroits. Tous les aigrefins que cette galéjade conforte dans leurs dogmes applaudissent, pour la plus grande fierté des benêts.-
Il faut avoir été à l’école...longtemps....longtemps...longtemps....pour accepter l’argent comme une marchandise. ET....il faut avoir une" tête " pour accpeter les interets....et le mensonge arrive...et on veut se faire respecter...et ...ET il ne reste que la ’force’ pour cela. ALORS, le monde fonctionne comme il peut...en équilibre par le conflit.
Et pendant ce temps, le monde se meurt......-
Cet article ne prend pas en compte la production des BIENS DURABLES en économie de croissance. En effet le poisson et le blé sont des biens périssables. Etant donné la consommation des deux protagonistes tant qu’on en reste là ça fonctionne. Maintenant sur la même île déserte imaginons que l’économie soit en croissance. Le pêcheur travaille et innove pour créer des coffres où ranger l’or. Les coffres c’est du durable. Il arrive à vendre jusqu’à 10 coffres à l’agriculteur pour 100 g Or, et arrête de pêcher du coup, parce qu’il n’a plus besoin que ça pour gagner de l’argent dans un premier temps. L’agriculteur travaille plus, mais gagne plus, puisqu’il ne paie plus le poisson, il encaisse dans un premier temps un petit peu. A ce moment là le producteur de coffres qui s’est construit un nouveau coffre pour lui, comprend qu’à terme s’il ne fait rien, il faudra retourner à la pêche quand son capital aura fondu à l’achat du blé. Il innove, il crée un nouveau bien durable, il crée... Un Canapé ! Qu’il estime à : 100 grammes d’or (il a déjà tout l’or de la vente de ses coffres). L’agriculteur serait bien tenté par le canapé, mais il n’a pas d’Or en ce moment ! (Il est d’accord sur le prix). Qu’à cela ne tienne lui dit le pêcheur, je te fais un prêt avec intérêts de 100 grammes d’Or pour le canapé ! Ok. C’est parti donc, avec l’argent récupéré du prêt le pêcheur peut continuer à acheter du poisson, mais l’agriculteur lui ne tésaurise pas ou très peu (sauf en biens durables puisqu’il a 1 canapé et 1 coffre !). Mais ça lui suffit. Là l’agriculteur dit au pêcheur : bon je t’achète plus rien j’attends d’avoir remboursé mon prêt, et en attendant il tésaurise. Le pêcheur paye son blé, et travaille à créer de nouveaux produits encore plus chers, plus mieux et tout et tout, ce qui est légitime. Seulement arrivé au bout de sa tésaurisation, l’agriculteur qui a payé son prêt, et tésaurisé 100 g d’or, ne veut plus emprunter pour se payer le nouveau truc génial créé par le pêcheur : un réfrigérateur au lait de coco, proposé à 300 g d’Or. Il dit "je préfère attendre et payer cash", dans 3 mois j’aurai tésaurisé 300 g d’Or ça ira très bien, pourquoi payer des intérêts ? C’est son droit très légitime ! Bilan à ce moment là des biens durables : 1 coffre créé pour 100g d’Or de valeur + 1 canapé à 100g, + un réfrigérateur au lait de coco à 300 g d’Or. = 500 g d’Or. Argent réel = 100 g d’Or. Crise. Le pêcheur peut être tenté de brader son réfrigérateur pour rien pour vivre tout de suite (Il sera floué car à 100g d’Or la vente, ça ne paye pas le nombre de jours de travail réalisé, ni la création de valeur que constitue cette innovation). I doit réfléchir sérieusement à sa subsistance, soit revenir au temps des cavernes à pêcher, soit se mettre au service de celui qui a le capital : l’agriculteur s’il veut bien de lui etc... Chômage, problèmes, etc... Et pourtant ce réfrigérateur il aurait été bien utile ! Si on avait créé de la monnaie en proportion de la création de valeur (Canapé, Coffres...) dans une proportion raisonnable le problème ne serait pas arr ivé .-
@Galuel
Le blé est un bien durable. Un blé bien sec se conserve bien.Le poisson fumé et salé se conserve bien. Ces deux biens économiques se conservent tous les deux une ou plusieurs années.
Vous développez la robinsonade avec la fabrication de coffre, de canapé et meme de refrigerateurs. Une robinsonade doit isoler arbitrairement un seul aspect de la realité. Une robinsinade ne doit pas chercher a imiter toute la complexité de la realité.
J’ai du mal à bien comprendre votre texte car vous ne le séparez pas en paragraphe homogenes. -
Gül, le Retour II 4 janvier 2009 18:47Heu...M’sieur, j’pourrais avoir une tranche, sur une petite choucroute avec un beurre blanc ??? Non, ben, faut pas déconner non plus !!! Tant qu’à demander des trucs impossibles autant le faire avec chic !!!

Salut Cap’tain préféré !
-
-
@quen_tin
Vous citez un lien parlant d’un physicien. Ce qu’en rapporte l’auteur de ce billet, ce brillant physicien montre, à mon avis, une totale ignorance de la science économique. Il ignore autant l’existence des theories économiques, que leurs pratiques, que la manière dont sont enseignées les sciences économiques. -
@GDM
Le banquier ne réinjecte jamais les intérêts sur le marché. Votre "démonstration" étant basée sur cette fausse idée, cela la rend complétement démonstrative... de rien du tout.
Si les intérêts, dans leur totalité, servaient à payer les salaires des banquiers, alors votre démonstration serait juste. Mais ça ne se passe pas ainsi.
-
@Armand
Ma robinsonade, telle que j’ai rédigé mon article, n’est pas une démonstration suffisante. En effet, par souci excessif de simplification, j’en ai trop réduit la portée. En réponse à ecophilpat, j’ai rédigé une autre robinsonade plus convaincante. Vous pouvez la lire ci-dessus.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON